29/10/2025
David Martin, une trajectoire de foi et de résistance
À l’aube du 17e siècle, la France croit enfin en la paix. L’Édit de Nantes, signé en 1598, semble résoudre les conflits meurtriers qui avaient opposé prote...
Face aux traductions issues du protestantisme, le catholicisme français s'efforce de fournir aux clercs, en particulier, une Bible dont l'origine est reconnue par l'Église et exempte de termes susceptibles de poser problème à son enseignement.
Article écrit le 29/10/2025
Pendant que la Bible de Louvain gardait au début du 17e siècle sa prédominance, la volonté de présenter un texte français d’origine catholique se manifestait même au sein du pouvoir. Ainsi, Richelieu soutint le travail d’un non ecclésiastique, Jacques Corbin, avocat, conseiller du roi et littérateur qui réalisa une traduction de la Bible en 8 petits volumes in16°, donc d’un format très maniable et qu’on n’envisageait pas pour un usage liturgique. Le titre l’annonce comme une « nouvelle traduction très élégante, très littérale et très conforme à la vulgaire du Pape Sixte V ». En sous-titre pour asseoir son autorité, on précise bien : « Revue et corrigée par le très express commandement du Roy : et approuvée par les docteurs en la Faculté de Théologie de l’Université de Poitiers ». Publiée en 1643, puis 1662, cette Bible sera vivement critiquée, selon certains pour son style « barbare », pour d’autres parce que trop littérale. Ces éditions n’eurent pas un grand succès.
Plus tard, l’Assemblée du Clergé de France demanda une traduction du Nouveau Testament en français à Denys Amelote, prêtre et docteur en théologie à la Sorbonne. Éditée en 3 volumes de 1666 à 1670, contenant des sommaires, des arguments et des notes, elle sera largement diffusée. Denys Amelote veut prouver qu’il n’en est pas resté à la traduction en français à partir du latin de la Vulgate. Bien qu’il entende respecter les décisions du Concile de Trente, il écrit néanmoins : « En mille endroits où le Latin me laisse dans les ténèbres, je prends le Grec pour mon guide et pour mon flambeau ; et je tire de sa force et de son abondance des richesses, que les paroles Latines ne m'auraient jamais découvertes. »
Dans le souffle des parutions de la Bible de Port-Royal, de très nombreuses traductions se font jour. Citons celle des Évangiles en 1697 du P. Bouhours, jésuite et littérateur, qui cherchait à développer une langue élégante dans son style, ce qui lui fut reproché. Dans sa préface, il affirme sa volonté de traduire non à partir du grec mais de la Vulgate pour respecter les recommandations du Concile de Trente. Mais plus loin, il ajoute que les différences du latin avec le grec sont minimes et ne touchent pas le sens. Cela dit, il annonce faire usage du grec pour éclairer son texte. Tout le monde sera ainsi tranquillisé ? On pourrait également citer de nombreuses traductions des Psaumes, parfois périphrasés, certaines de bonne qualité comme Macé (1688) et d’autres encore : Coquelin (1686) ou Choisy (1687) qui, pour l’anecdote fut ambassadeur de Louis XIV auprès du roi de Siam.
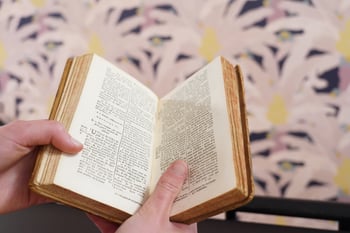
En 1613, Louis-Isaac Le Maistre de Sacy voit le jour dans une famille d’avocats et d’intellectuels parisiens. Sa mère, Catherine Arnauld, appartient à une lignée prestigieuse, et sa tante est abbesse de Port-Royal. Dès son plus jeune âge, il s’attache à cette communauté religieuse, qui deviendra un centre majeur de la pensée janséniste. Le jansénisme, inspiré par les écrits de saint Augustin, propose une vision austère de la foi chrétienne, centrée sur la grâce divine et la prédestination. En conflit avec les jésuites, ce courant insiste sur l’incapacité humaine à obtenir le salut sans l’intervention de Dieu.
Ordonné prêtre en 1649, Sacy se fait rapidement remarquer pour ses qualités pastorales et intellectuelles. Associé aux « solitaires de Port-Royal », il entreprend la traduction du Nouveau Testament, une tâche ambitieuse dans un contexte religieux marqué par des tensions entre catholiques et protestants, ainsi qu’au sein même de l’Église catholique. Ce projet reflète également les débats intellectuels autour de la lecture et de l’interprétation des Écritures.
En 1667, Port-Royal publie le Nouveau Testament, également connu sous le nom de Nouveau Testament de Mons parce qu’il est publié à Mons, aux Pays-Bas, faute d'approbation en France de l’Université de Paris. Réalisée principalement par Le Maistre de Sacy, cette traduction connaît un succès remarquable, avec plus de 5 000 exemplaires vendus en six mois. Cependant, elle suscite des critiques sévères. Bossuet la trouve "trop polie" dans son style, et plusieurs évêques en interdisent la lecture. Le pape Clément IX va jusqu’à menacer d’excommunication les lecteurs, craignant l’influence janséniste qu’elle pourrait véhiculer.
Entre 1666 et 1668, alors qu’il est emprisonné à la Bastille, Sacy commence à travailler sur la traduction de l’Ancien Testament. Libéré, il reprend son œuvre dans un contexte toujours hostile, marqué par les attaques de Louis XIV contre Port-Royal, sous l’influence des jésuites. Ce travail aboutit entre 1672 et 1693 à la publication par Port-Royal de l’ensemble de l’Ancien Testament, réparti en 32 volumes in-8° qui paraissent donc en plus de vingt ans.
Cette publication associe le texte latin de la Vulgate et sa traduction en français, enrichie de quelques variantes grecques ou hébraïques. Fidèle à son style clair et élégant, Sacy s’efforce de rendre les Écritures accessibles tout en préservant leur richesse spirituelle. Les volumes comprennent des commentaires détaillés, expliquant le sens littéral, spirituel et moral des Écritures, témoignant ainsi de l’héritage théologique et intellectuel de Port-Royal. Mais ces commentaires ne seront plus réédités, sauf une fois en 1730 et une autre à la fin du 18e siècle. Seule, la traduction de Sacy sera éditée, reprise, révisée jusqu’au 19e siècle. Elle fut la traduction du Grand siècle. Louis-Isaac Le Maistre de Sacy décède en 1684 à l’âge de 71 ans.

Auteur de podcasts pour l’Alliance biblique française et conseiller pour la bibliothèque historique.
29/10/2025
À l’aube du 17e siècle, la France croit enfin en la paix. L’Édit de Nantes, signé en 1598, semble résoudre les conflits meurtriers qui avaient opposé prote...
Lire l'article
29/10/2025
Au 16e siècle, les Pays-Bas sont sous l’autorité des Habsbourg, d’abord gouvernés par Charles Quint, puis par son fils Philippe II d’Espagne. Vers le milie...
Lire l'article
29/10/2025
René Benoist, né en 1521 à Angers, entre dans l’histoire comme un érudit audacieux, un théologien engagé, mais aussi comme une figure controversée de son é...
Lire l'article
29/10/2025
Pierre Robert Olivétan voit le jour vers 1506, en Picardie, dans une famille modeste mais avide de savoir. Ce jeune Picard commence son éducation dans sa r...
Lire l'article
29/10/2025
Sébastien Castellion (1515 -1563), est un personnage attachant de la Réforme. Issu d’une famille pauvre de la région lyonnaise, il parvient à poursuivre de...
Lire l'article