29/10/2025
Traductions catholiques après la Révolution
Pourquoi la Bible de Sacy poursuit sa carrière Au 19ᵉ siècle, les éditeurs choisissent souvent la traduction de Sacy pour publier des Évangiles ou des Bibl...
Article écrit le 29/10/2025
Pierre Robert Olivétan voit le jour vers 1506, en Picardie, dans une famille modeste mais avide de savoir. Ce jeune Picard commence son éducation dans sa région, puis se dirige vers l’Université d’Orléans, où il approfondit sa formation en théologie et en lettres. C’est là qu’il forge ses premières idées, dessinant les contours de son engagement intellectuel.
Vers la fin de son parcours universitaire, Olivétan est attiré par Strasbourg, le centre vibrant de la Réforme naissante. Sous la direction de Martin Bucer, ancien dominicain et fervent réformateur, il s’immerge dans l’hébreu et le grec, des langues essentielles pour quiconque veut explorer les textes bibliques originaux. Ce séjour marque une étape déterminante dans son parcours.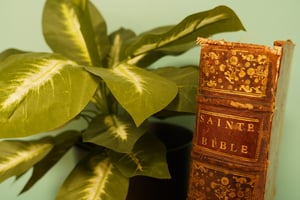 En 1530, il choisit de s’installer en Suisse, un choix mûrement réfléchi pour un homme prêt à franchir le pas vers la traduction biblique. Ce projet audacieux de traduire la Bible en français sera encouragé et financé par les Vaudois du Piémont. Ce mouvement chrétien né au 12e siècle, est attaché à son indépendance spirituelle et prône un retour à l’Évangile. Déjà son fondateur Valdo (ou Valdès) avait mis au cœur de sa mission l’enseignement à partir de la Parole biblique traduite en langue romane.
En 1530, il choisit de s’installer en Suisse, un choix mûrement réfléchi pour un homme prêt à franchir le pas vers la traduction biblique. Ce projet audacieux de traduire la Bible en français sera encouragé et financé par les Vaudois du Piémont. Ce mouvement chrétien né au 12e siècle, est attaché à son indépendance spirituelle et prône un retour à l’Évangile. Déjà son fondateur Valdo (ou Valdès) avait mis au cœur de sa mission l’enseignement à partir de la Parole biblique traduite en langue romane.
L’année 1532 marque un tournant crucial pour les Vaudois. Réunis au cœur du Val d’Angrogne, ils tiennent un synode historique. Face à une Église catholique hostile et aux tensions religieuses qui secouent l’Europe, ils choisissent de s’aligner sur la Réforme et le français devient pour eux une langue d’émancipation, même s’ils parlent encore l’Occitan. Guillaume Farel, lors de ce rassemblement, préconise même Pierre Robert Olivétan comme traducteur de leur Bible en français, scellant un pacte spirituel avec la Réforme. Les vaudois souhaitaient une version bilingue (latin/français) qui ne sera pas retenue.
Le travail de traduction d’Olivétan commence véritablement en 1533. Son cousin Jean Calvin, écrira la préface de cette future Bible. Olivétan se lance dans cette tâche titanesque, parfois sous des pseudonymes comme « Belisem de Belimakom » (« le sans-nom de nulle part ») pour éviter les représailles. Cet érudit, maniant habilement l’hébreu, le grec et le latin, n’est pas seul. Autour de lui, des collaborateurs fidèles préparent des tables de noms propres et des sommaires pour chaque livre biblique, le soutenant dans cette entreprise unique. Les outils de l’époque sont rares et imprécis, mais qu’importe ! Olivétan ne se contente pas des sources habituelles. Il consulte la prestigieuse Biblia Rabbinica de Daniel Bomberg, publiée à Venise, riche de commentaires de penseurs juifs comme Rachi, Kimhi, et Maïmonide. Il examine aussi la Vulgate de Jérôme, mais vise une traduction au plus près des textes hébreux et grecs, marquant ainsi une rupture claire avec les éditions catholiques. Il consulte la Bible de Lefèvre d’Étaples en français, se plonge dans des ouvrages latins comme la Bible de Sante Pagnini, traquant la précision. Il utilisera à titre de comparaison trois versions allemandes et deux italiennes.
Olivétan, dans sa traduction, choisit des mots adaptés à son époque, comme « hanap » pour désigner une coupe, à la place de « calice » (qui n’est qu’une répétition du latin), ou encore « surveillants » pour les évêques et « sacrificateurs » pour les prêtres, un vocabulaire pensé pour rompre avec la terminologie catholique. Soucieux de précision, Olivétan n’hésite pas à annoter les marges, ajoutant des variantes pour éclairer ses choix. En 1535, après deux à trois années de travail acharné, la première Bible en français traduite directement de l’hébreu et du grec, voit le jour. Son format imposant et ses caractères gothiques limitent sa diffusion, mais cette Bible marque une étape décisive pour les Vaudois et sera une première étape pour ceux qui souhaitent accéder au texte biblique dans leur langue. Cette édition pionnière restera un trésor rare, souvent révisé par la suite. En 1540, à Genève, le texte original d’Olivétan subit sa première révision. Jean Calvin et une équipe de réformateurs y ajoutent leur marque en s’efforçant de clarifier le texte, d’épurer les lourdeurs, de corriger les erreurs et de le rendre plus proche des principes de la Réforme. Le résultat ? Une version tranchante, incisive, surnommée « Bible de l’Épée ».
En 1535, après deux à trois années de travail acharné, la première Bible en français traduite directement de l’hébreu et du grec, voit le jour. Son format imposant et ses caractères gothiques limitent sa diffusion, mais cette Bible marque une étape décisive pour les Vaudois et sera une première étape pour ceux qui souhaitent accéder au texte biblique dans leur langue. Cette édition pionnière restera un trésor rare, souvent révisé par la suite. En 1540, à Genève, le texte original d’Olivétan subit sa première révision. Jean Calvin et une équipe de réformateurs y ajoutent leur marque en s’efforçant de clarifier le texte, d’épurer les lourdeurs, de corriger les erreurs et de le rendre plus proche des principes de la Réforme. Le résultat ? Une version tranchante, incisive, surnommée « Bible de l’Épée ».
Les décennies passent, avec des révisions intermédiaires (1546) moins importantes. En 1562, Théodore de Bèze reprend la révision pour répondre aux nouvelles attentes des fidèles. Genève est devenue un lieu refuge pour les protestants persécutés. Bèze ajuste le texte pour en améliorer la compréhension, insérant des annotations doctrinales qui guideront les fidèles dans leur lecture.  La Bible de Genève consolide ainsi sa place dans les communautés réformées, jetant les bases d’une tradition biblique distincte, et ce texte, standardisé, ne cessera de se diffuser. L’an 1588, voici une nouvelle version qui sera pour beaucoup « officielle ». Elle est sous-titrée « Revue et conférée sur les textes hébreux et grecs par les Pasteurs et Professeurs de l’Église de Genève ». Et l’histoire des révisions de la Bible de Genève n’en restera pas là…
La Bible de Genève consolide ainsi sa place dans les communautés réformées, jetant les bases d’une tradition biblique distincte, et ce texte, standardisé, ne cessera de se diffuser. L’an 1588, voici une nouvelle version qui sera pour beaucoup « officielle ». Elle est sous-titrée « Revue et conférée sur les textes hébreux et grecs par les Pasteurs et Professeurs de l’Église de Genève ». Et l’histoire des révisions de la Bible de Genève n’en restera pas là…
Notons, dans une édition de Robert Estienne en 1553, l’apparition de la numérotation des versets qui deviendra commune à toutes les bibles. Pour en revenir à Pierre Robert Olivétan, sa vie s’achève prématurément. En 1538, il disparaît mystérieusement à Ferrare, en Italie.

Auteur de podcasts pour l’Alliance biblique française et conseiller pour la bibliothèque historique.
29/10/2025
Pourquoi la Bible de Sacy poursuit sa carrière Au 19ᵉ siècle, les éditeurs choisissent souvent la traduction de Sacy pour publier des Évangiles ou des Bibl...
Lire l'article
29/10/2025
Sébastien Castellion (1515 -1563), est un personnage attachant de la Réforme. Issu d’une famille pauvre de la région lyonnaise, il parvient à poursuivre de...
Lire l'article
06/07/2023
Dès 1946, les sociétés bibliques choisissent de former une fraternité mondiale dans laquelle les ressources financières sont mises en commun afin que la Bi...
Lire l'article
29/10/2025
René Benoist, né en 1521 à Angers, entre dans l’histoire comme un érudit audacieux, un théologien engagé, mais aussi comme une figure controversée de son é...
Lire l'article
29/10/2025
Image d’une situation Quand Guillaume Briçonnet prend ses fonctions d’évêque de Meaux en 1516, il se retrouve face à une situation bien particulière : un d...
Lire l'article
29/10/2025
La Bible au 17e siècle avant Sacy
Lire l'article